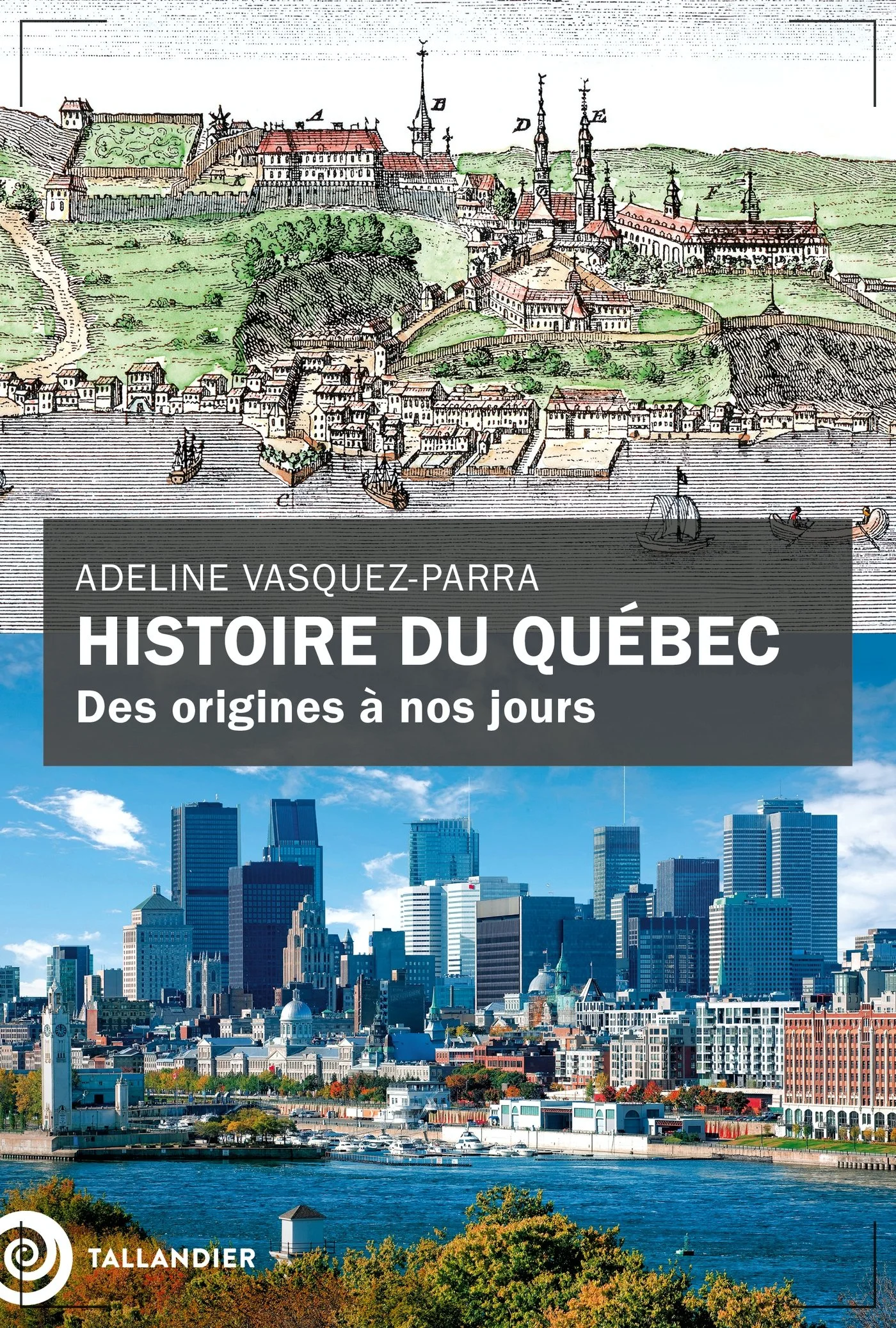Recomposer les mémoires féministes du Québec : quand l’histoire nationale devient plurinationale
Chaque octobre, le Mois de l’histoire des femmes invite le Canada à célébrer celles qui, connues ou restées dans l’ombre, ont contribué à bâtir un pays plus égalitaire. Instituée en 1992 par le gouvernement fédéral, cette commémoration rend hommage aux femmes qui ont marqué la politique, la culture, la science ou la vie communautaire, et culmine le 18 octobre avec la Journée de l’affaire « Personne », symbole de la reconnaissance légale des femmes comme « personnes » au sens de la loi.
Chaque année, la galerie virtuelle « Femmes d’influence au Canada », hébergée par le site du gouvernement, rassemble les portraits de ces pionnières.
Le 17 octobre 2025, Enflammé.e.s a rencontré Adeline Vasquez-Parra, docteure en histoire et maîtresse de conférences en civilisation nord-américaine à l’Université Lumière Lyon 2, chercheuse au laboratoire Triangle. Spécialiste de l’Amérique française et des migrations atlantiques, elle explore dans son ouvrage Histoire du Québec. Des origines à nos jours (Éditions Tallandier, 2025) la pluralité du récit québécois.
Adeline Vasquez-Parra interroge ici ce que révèle, ou dissimule, cette mémoire fédérale : comment le Québec féministe se raconte aujourd’hui entre héritages nationaux, luttes locales et voix issues des migrations.
Adeline Vasquez-Parra, docteure en histoire et maîtresse de conférences en civilisation nord-américaine à l’Université Lumière Lyon 2. D’origine chilienne, elle étudie les résistances minoritaires et les mémoires féministes et migrantes au sein de l’Amérique française. Ses recherches font écho, à distance, à la trajectoire de Caroline Dawson : deux voix venues du Chili, deux manières d’interroger l’appartenance, l’exil et la transmission. (Studio Reflex Photo)
Dans votre livre, vous insistez sur la pluralité du récit québécois : entre histoire nationale, voix autochtones et mémoire migrante. Cette perspective semble aussi traverser vos travaux sur les féminismes québécois. Qu’est-ce qui distingue l’histoire du féminisme québécois des autres récits féministes nord-américains ?
Adopter une approche plurinationale pour l’histoire du Québec, c’est relativement nouveau. C’est une histoire qui reste très nationale, au sens où elle s’est construite dans un cadre régional par rapport à l’histoire nord-américaine traditionnelle. Elle demeure donc marginale, aussi bien dans sa réception que dans sa production, et de surcroît, elle est en langue française, ce qui la place encore davantage en marge.
Ce que j’ai voulu faire à travers cette approche, c’est refuser de réduire ce récit national à des tensions binaires. Souvent, dans l’histoire du Québec, on résume tout à l’opposition entre colonisé et colonisateur, entre Français et Anglais, ou entre Montréal et les régions. Or, j’ai voulu reconnaître que le territoire québécois a toujours été traversé par des nations multiples, comme l’ensemble du territoire canadien, mais avec ses spécificités : les nations autochtones, canadiennes, françaises, immigrantes, diasporiques. Leurs rapports peuvent être harmonieux ou conflictuels, entremêlés, ambigus, mais aussi profondément créateurs.
C’est, je crois, un terrain particulièrement fertile pour comprendre les féminismes québécois, parce qu’on les a longtemps racontés à partir de ce double héritage : lutte nationale et lutte des femmes. Mais si l’on prend au sérieux la pluralité des appartenances, on découvre qu’il existe des féminismes québécois, au pluriel, traversés par des tensions qui complexifient la question du Québec elle-même.
Toutes les féministes ne parlent pas depuis la même idée de la nation : certaines la conçoivent comme un espace d’émancipation collective, d’autres comme un espace de dépossession, d’autres encore comme un lieu d’exil ou de fracture écologique. À travers cette histoire nationale, on peut donc convoquer différents types de féminismes, non pas en opposition, mais comme autant de voix participant d’une même histoire québécoise.
Dans cette vaste synthèse, Adeline Vasquez-Parra propose une lecture plurinationale et critique du récit québécois, articulant histoire politique, mémoire féministe, voix autochtones et expériences migrantes pour repenser la place du Québec dans l’histoire nord-américaine.
Le Mois de l’histoire des femmes au Canada met en avant une mémoire fédérale, souvent consensuelle. Comment concilier cette narration nationale avec la complexité du Québec, où l’histoire se construit dans la tension et la diversité ?
C’est vrai que, notamment à travers cette galerie du site du gouvernement fédéral, il y a un certain nombre de problèmes majeurs d’un point de vue historiographique. Cette vision fédérale souligne une forme d’identité pancanadienne qui s’est, depuis les années 1970, largement articulée autour du principe des communautés.
Je ne le critique pas : il faut évidemment reconnaître que la plupart des femmes sélectionnées ont apporté une contribution significative à leur communauté et qu’à certains endroits, cette contribution a pu rejaillir sur le collectif. Mais ce cadre tend à réduire la valeur des territoires, donc des provinces. On ne parle plus des événements collectifs qui ont façonné leur histoire, mais d’un récit des communautés dispersées à travers le Canada.
On remarque ainsi que l’histoire de l’Acadie, de l’Ouest canadien, de Terre-Neuve ou des régions à l’intérieur des provinces s’en trouve effacée. On a une vision très particulière, un peu post-nationale, du Canada depuis une vingtaine d’années, qui consiste à dire que la Confédération de 1867 n’est pas une entente entre provinces, mais une volonté de « faire pays ».
Et je crois que cela n’est pas en accord avec de petites sociétés comme le Québec, qui essaient d’exister et de mettre en valeur leurs spécificités. Ce qu’il faut aussi souligner à travers cette galerie, c’est qu’on ne juge pas l’action des femmes selon les mêmes critères que celle des hommes. On attend d’elles qu’elles aient non seulement réussi, mais aussi transformé la société : leur communauté, le collectif ou un niveau plus large.
Une femme doit avoir accompli un geste exceptionnel pour être reconnue comme « influente » dans le récit national. Alors qu’on a énormément d’hommes qui n’ont pas fait grand-chose, parfois une apparition lors d’une crise, et qui sont pourtant célébrés pour leurs idées, leurs fonctions, leur présence, sans aspect transformateur.
“Il faut aller chercher aussi des femmes qui, à leur échelle, ont fait des choses significatives, même sans transformer la société de manière gigantesque.” – Adeline Vasquez-Parra
C’est d’autant plus significatif que cette galerie constitue aussi une ressource pédagogique pour les écoles, avec des activités proposées aux élèves. Une telle démarche touche directement à la question de la transmission et de l’éducation…
Tout à fait. Quelle fonction veut-on donner à ce type d’initiative ? Parce que s’il s’agit de dire : « Allez chercher des femmes, mais seulement des femmes exceptionnelles », on crée déjà un biais de genre ; un biais dans la transmission même des stéréotypes.
Mois de l’histoire des femmes 2025. Un téléviseur rétro montrant cinq femmes.
De gauche à droite : Brenda Lucki, Janette Bertrand, Jean Augustine, Nicole Juteau et Dre Julielynn Wong de la galerie virtuelle Femmes d’influence au Canada. (Gouvernement du Canada)
Du féminisme québécois à la mémoire relationnelle : repenser l’histoire à partir des voix oubliées
Dans cette galerie, deux grandes figures québécoises attirent l’attention : Mary Two-Axe Earley et Léa Roback. Toutes deux ont incarné des formes d’engagement radicales, longtemps marginalisées avant d’être reconnues.
Que représente, pour vous, la reconnaissance institutionnelle de Mary Two-Axe Earley dans une galerie fédérale ? Est-ce un progrès ou une neutralisation de son message politique ?
Elle est membre de la communauté mohawk de Kahnawà:ke. C’est une communauté spécifique, étalée sur plusieurs provinces et aussi sur le territoire américain, notamment dans la région de New York, et anglophone. Il existe depuis longtemps une suspicion dans la collectivité québécoise vis-à-vis de cette communauté, notamment visible lors de la crise d’Oka, perçue parfois comme vectrice du fédéral.
Mary Two-Axe Earley, née en 1911, a été confrontée dans les années 1970 à la structure patriarcale du colonialisme canadien. Les réserves autochtones dépendant du droit fédéral, elle s’est retrouvée à la fois en opposition dans une province particulière et en lutte contre le gouvernement fédéral, à propos de la Loi sur les Indiens. Elle a perdu son statut d’Indienne en raison de son mariage avec un homme non-Autochtone ; or ce statut donne accès à des droits fonciers et successoraux essentiels.
Cette législation discriminait uniquement les femmes, pas les hommes. Il y avait donc à la fois une logique coloniale et une logique patriarcale. Son activisme, amorcé dans les années 1970, mènera à la réforme de 1985 (projet C-31), inscrite dans le contexte plus large des mouvements autochtones nord-américains et des luttes féministes de la seconde vague.
Ce qui distingue Mary Two-Axe Earley, c’est sa capacité à relier la revendication spécifique du statut des femmes à une critique systémique du colonialisme et du racisme d’État. Cela la distingue de nombreuses militantes autochtones de son époque.
La deuxième, Léa Roback, offre un dialogue intéressant avec elle. Toutes deux remettent en cause le récit homogène d’une société qui efface des voix vulnérables : issues de communautés marginalisées, de milieux populaires, elles inscrivent leurs luttes à plusieurs échelles : locale, provinciale, nationale et transnationale. Léa Roback, par exemple, a vécu à Berlin ; son expérience allemande a profondément marqué son militantisme lorsqu’elle revient à Montréal dans les années 1930-1940.
En quoi le parcours de Léa Roback éclaire-t-il les liens entre féminisme, classe et immigration au Québec ?
Elle est née dans une famille juive immigrée de Pologne et installée à Montréal. Ce n’était pas rare, mais elle faisait partie d’une minorité migrante et religieuse dans une province extrêmement catholique, marquée par le clérico-nationalisme du début du 20ᵉ siècle, qui associait religion et nation. Cela marginalisait des personnes comme elle, pourtant nées au Québec.
Elle s’engage très tôt dans le Parti Communiste du Québec et participe à la grande grève des travailleuses du textile dans les années 1930. Ouvrière issue d’un milieu modeste, elle représente le vécu des classes populaires par l’engagement socialiste.
Elle subit une double marginalisation : issue d’une minorité culturelle et militante communiste, idéologie rejetée par le clergé. Elle devient un paria dans la société québécoise de l’époque. C’est intéressant de mettre en valeur ces femmes qui n’ont pas fait consensus, ni dans le mouvement féministe ni dans la société.
Vous évoquez aussi Caroline Dawson, écrivaine d’origine chilienne installée à Montréal et absente de la galerie. Son œuvre Là où je me terre (Éditions du remue-ménage, 2020) articule mémoire de l’exil, voix des femmes migrantes et critique du récit national. Que révèle, selon vous, cette absence ?
Cela signifie plusieurs choses. D’abord, Caroline Dawson a eu un parcours tragique : elle est décédée récemment alors qu’elle était en pleine reconnaissance [N.D.L.R. Atteinte d’un cancer des os depuis 2021, elle est décédée le 19 mai 2024]. Sociologue, arrivée du Chili à l’âge de sept ans, elle a ouvert une voie nouvelle dans l’écriture migrante au Québec, en y introduisant une portée transnationale et mémorielle.
Elle a montré que, même inscrite dans une société particulière, le Québec francophone, une personne peut porter en elle d’autres mémoires capables d’enrichir la société d’accueil. Ce n’était pas une simple « réussite migrante » : elle écrivait sur la migration tout en montrant que la mémoire migrante apporte des leçons, notamment sur la démocratie.
Elle a écrit sur les traumatismes de la dictature chilienne et sur leurs répercussions dans les familles d’exilés politiques ; un sujet longtemps tabou, y compris au sein de la diaspora chilienne. Elle est la première femme francophone à avoir pris la parole sur ce thème et à avoir trouvé un écho dans sa société.
Elle a montré que la migration n’efface pas les blessures : il existe toujours une tension entre intégration et fidélité aux origines. Elle a aussi révélé les difficultés liées à la multiplicité des appartenances et à l’ambivalence envers la langue maternelle ou et le pays d’origine.
Caroline Dawson illustre une nouvelle forme de féminisme, à la fois migratoire et mémoriel, où les femmes jouent un rôle central dans la transmission des idées politiques. Elle a montré que des femmes modestes, comme sa mère, femme de ménage, peuvent transformer la vie d’une génération par des gestes simples : amener ses enfants à la bibliothèque, et transmettre la curiosité intellectuelle.
Ses travaux continuent-ils d’être diffusés aujourd’hui ?
Oui, il y a une véritable volonté de valoriser ce qu’elle a fait. Le prix Caroline Dawson* a été créé et est décerné par Radio-Canada depuis 2024 ; il récompense un roman ou un essai publié en français par un écrivain émergent issu de la diversité.
Son roman Là où je me terre a également été republié en 2025 aux Éditions de l’Olivier, ce qui permet de la faire connaître au-delà du Québec. C’est un texte qui résonne à l’échelle mondiale, puisque des réfugiés politiques chiliens ont été dispersés un peu partout dans le monde.
Il existe d’ailleurs une vraie résonance entre le Chili et le Québec. Dans les années 1970, les nationalistes québécois admiraient le modèle chilien de Salvador Allende, cette idée d’une « petite nation » autonome. Il y a eu de véritables solidarités entre ces deux sociétés, toutes deux confrontées à des logiques impériales et économiques dominantes.
Cette filiation symbolique explique aussi pourquoi le travail de Caroline Dawson trouve un écho particulier : il parle à la fois d’exil, de mémoire, et d’une identité nationale en mouvement.
Quelles femmes ou quelles voix gagneraient encore à être réhabilitées dans le récit québécois ?
Faire de l’histoire féministe, ce serait aller vers des femmes plus modestes, dont l’impact n’a pas été transformateur à grande échelle. Il faut arrêter de chercher des héroïnes consensuelles. Beaucoup de femmes ont agi à des échelles familiales, religieuses ou communautaires, qui sont essentielles mais souvent négligées.
Il faudrait juger l’action féminine à sa propre échelle, plutôt que de la mesurer à celle des hommes. Ces sphères jugées « petites » (la famille, la paroisse, la communauté) sont en réalité des lieux déterminants de transmission et de solidarité.
On oublie aussi l’importance des femmes dans l’histoire des provinces. En Acadie, par exemple, petite société non reconnue politiquement, la contribution des femmes à la reconnaissance nationale est souvent effacée. Une figure à redécouvrir serait Mathilda Blanchard, grande syndicaliste acadienne qui a lutté pour les droits des femmes et pour les salaires des ouvrières de pêcherie.
Aller chercher l’histoire des territoires plutôt que celle des seules communautés permettrait de valoriser ces figures méconnues et de mieux comprendre la diversité socio-économique et politique du Canada atlantique comme du Québec.
Comment transmettre cette histoire plurielle aux jeunes générations ?
Je pense qu’il existe aujourd’hui de nombreux supports pour valoriser les femmes dans l’espace public : réseaux sociaux, podcasts, formats courts, adaptés aux usages des jeunes.
Plutôt que d’imposer une injonction du type « il faut s’intéresser à l’histoire des femmes », il faut relier ces figures à des enjeux contemporains : environnement, identité de genre, justice sociale.
Les femmes autochtones, par exemple, se battent contre des projets pétroliers ; d’autres luttes féministes résonnent avec les préoccupations actuelles. Il s’agit donc de placer ces femmes dans des récits vivants, qui parlent à la jeunesse et montrent combien leurs combats s’inscrivent encore dans le présent.
Ce Mois de l’histoire des femmes au Canada offre un point d’entrée précieux pour revisiter les récits féminins du passé. Comment prolonger cette réflexion au-delà d’une commémoration ponctuelle ?
Revenir sur l’histoire du féminisme québécois, c’est aussi revenir sur une histoire commune du Québec. Le but n’est pas de montrer une société éclatée, mais de construire une histoire commune en déplaçant le centre de gravité du récit : passer d’une mémoire héroïque nationale à une mémoire relationnelle.
Cette histoire met en dialogue des trajectoires, des silences, des traces éphémères.
C’est une manière de penser autrement les frontières : non plus comme des lignes de séparation, mais comme des zones de passage et de traduction politique.
-
*Créé par Radio-Canada, le prix Caroline-Dawson récompense chaque année, au mois de novembre, une autrice ou un auteur francophone émergent dont l’œuvre — roman ou recueil de poésie publié au Canada entre août et juillet de l’année précédente — met en lumière les réalités et les défis vécus par des personnes issues de la diversité. Les traductions ne sont pas admissibles.
-
Présentation de l’ouvrage d’Adeline Vasquez-Parra, Histoire du Québec : des origines à nos jours, (Éditions Tallandier, 2025) lors de la présentation conjointe de trois nouveaux ouvrages :
Elena Choquette, Land and the Liberal Project : Canada’s Violent Expansion, UBC Press, 2024 :
Étienne Faugier, Les Québécois au volant. La révolution de l’automobilisme dans la région de Québec, XIXe-XXe siècles, Septentrion, 2025).
Quand ?
Le vendredi 14 novembre de 16h30 à 18h30.
Où ?
Au Centre Berthelot, espace Marc Bloch, MSH de Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon, en partenariat avec l’Institut des Amériques.
Possibilité de suivre à distance (lien Zoom possible si demandé).
Plus d’informations ici.