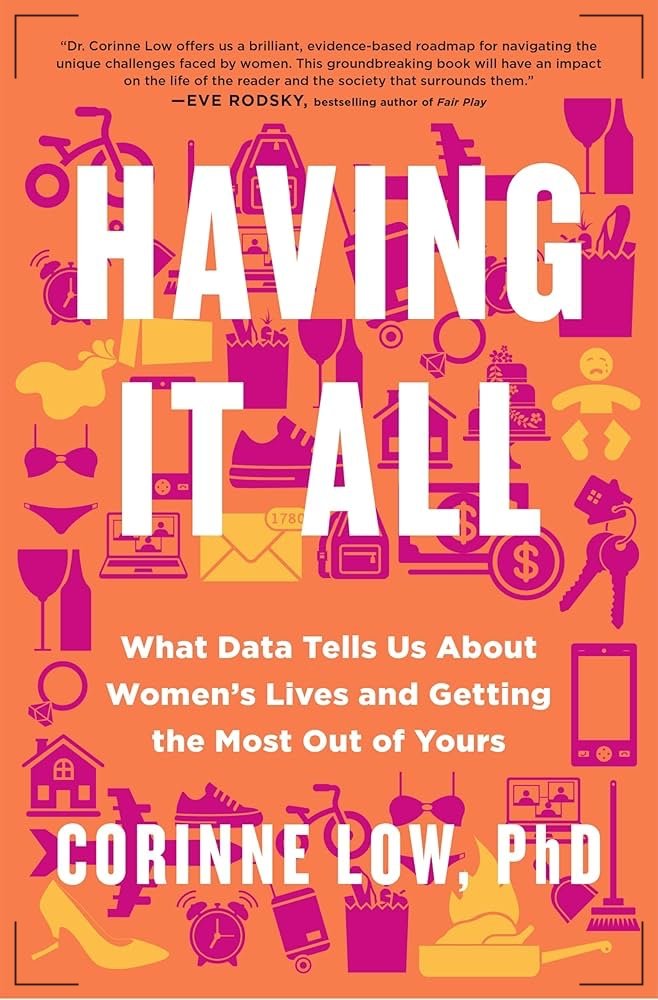Réussir professionnellement ne protège pas les femmes des inégalités dans le couple
Professeure d’économie à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, Corinne Low consacre ses recherches aux inégalités de genre et aux discriminations. Son premier ouvrage, Having It All : What Data Tells Us About Women's Lives and Getting the Most Out of Yours, publié le 23 septembre 2025 aux États-Unis par Flatiron Books, s’attaque à une question aussi intime que politique : pourquoi les femmes, même lorsqu’elles réussissent, paient-elles si cher l’illusion de « tout avoir » ?
En mobilisant des données économiques de pointe et en croisant son regard scientifique avec des expériences vécues, elle dévoile le poids invisible du travail domestique, les pièges du marché du travail et les déséquilibres institutionnels, du droit matrimonial à la garde d’enfants. Corinne Low ne se contente pas de dresser un constat : elle trace aussi des pistes concrètes pour repenser l’organisation du travail, la reconnaissance du care et les contrats conjugaux.
Dans cet entretien exclusif accordé à Enflammé.e.s le 15 septembre 2025, elle partage une approche lucide et ambitieuse, qui replace l’économie au cœur des choix de vie des femmes.
Professeure associée en économie à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, docteure en économie de Columbia et ancienne consultante chez McKinsey, Corinne Low consacre ses recherches aux inégalités de genre et s’engage aussi dans la lutte contre la crise du logement à New York.
Une étude [1]du National Women’s Law Center [2] (NWLC), basée sur les données du Bureau of Labor Statistics [3] (BLS), a révélé que de plus en plus de femmes quittent le marché du travail, tandis que la participation des hommes progresse. Comment ce constat s’articule-t-il avec votre thèse selon laquelle les femmes composent avec des contraintes structurelles, plutôt que de « faillir » individuellement ?
Quitter le marché du travail est souvent perçu comme un choix personnel. Mais, en réalité, nombre de femmes se heurtent à des contraintes structurelles qui rendent leur maintien dans l’emploi tout simplement intenable. Pour certaines, c’est un calcul économique : leur salaire couvre à peine, voire pas du tout, le coût de la garde d’enfants. Dans d’autres cas, ce sont des vagues de licenciements dans des secteurs comme l’éducation ou la fonction publique, qui frappent de façon disproportionnée les femmes.
Cette dynamique n’est pas propre aux États-Unis : dans de nombreux pays occidentaux, les avancées en matière de participation des femmes au marché du travail et de réduction de l’écart salarial se sont brutalement interrompues. Ce coup d’arrêt témoigne d’un problème structurel, non d’un manque d’ambition individuelle.
Dans Having It All, Corinne Low s’appuie sur des données économiques de grande ampleur, qui concernent presque exclusivement les couples hétérosexuels. Les dynamiques décrites — écarts de revenus, partage du travail domestique, droit matrimonial — reflètent donc cette norme statistique. Les couples de même sexe ne sont pas abordés spécifiquement, faute de données comparables, mais les enjeux qu’ils rencontrent mériteraient des analyses dédiées.
Votre introduction « So. Darn. Tired. » exprime une fatigue personnelle profonde. Estimez-vous que la tendance mise en lumière par le NWLC et le BLS traduit, dans les indicateurs macroéconomiques, cette lassitude qui s’accumule depuis des années ? »
Les données montrent que le bien-être des femmes décline depuis plus de dix ans. Je parle moins d’écart salarial que d’écart de bonheur entre les sexes. Cet indicateur est éloquent : lorsque des femmes financièrement sécurisées peuvent se permettre de se retirer du marché du travail, beaucoup le font — preuve que le système ne fonctionne pas. Ce n’est pas de la paresse ; c’est une réponse rationnelle à des exigences intenables.
S’il ne devait rester qu’une seule mesure de politique publique à retenir, ce serait celle-ci : intégrer les responsabilités de soin et de famille dans la sphère économique. Cela suppose de repenser les attentes professionnelles et de reconnaître à la fois le coût, et la valeur, du travail domestique non rémunéré.
Quand les contraintes structurelles freinent l’ambition
Même lorsqu’elles sont les principales pourvoyeuses de revenus, les femmes continuent d’assumer davantage de tâches domestiques — environ deux fois plus de cuisine et de ménage. Qu’est-ce que cela révèle de la manière dont les entreprises évaluent le « mérite » et le potentiel ?
De nombreuses entreprises fonctionnent encore selon un modèle dépassé, qui attend une dévotion totale au travail de la part de salarié.es qui, historiquement, avaient quelqu’un à la maison pour gérer le reste. Ce n’est plus la réalité. Le fait que les femmes, même pourvoyeuses principales de revenus, continuent d’assumer plus de tâches domestiques non rémunérées signifie qu’elles doivent composer avec un temps plus contraint et davantage de stress.
Ce qui m’inquiète, c’est que si les entreprises se contentent de constater ces contraintes, elles risquent d’en tirer la mauvaise conclusion : « Alors pourquoi embaucher des femmes ? » Ce serait une interprétation dangereuse. Alors qu’en réalité, ces responsabilités atteignent un pic durant une période de vie limitée ; ce que j’appelle l’étau (the squeeze).
Concrètement, comment leurs systèmes d’évaluation devraient-ils évoluer ? »
Il faut repenser la manière dont on mesure la performance : récompenser l’efficacité, reconnaître les phases de care comme de véritables périodes d’investissement, et évaluer les résultats, pas seulement le nombre d’heures passées au bureau. Si les entreprises investissent pour accompagner leurs salariées durant cette étape, elles bénéficieront ensuite pleinement de leur productivité sur le long terme.
Vous décrivez cette étape de vie comme « the squeeze » : le moment où l’investissement professionnel atteint son apogée alors que les exigences parentales s’intensifient. Quelles sont, au travail, dans les politiques publiques et au sein du foyer, les mesures les plus efficaces et les plus abordables pour desserrer cet étau ?
Au travail, une mesure clé consiste à mettre des limites aux horaires les plus coûteux. Les présences obligatoires au bureau devraient s’arrêter à 17 heures. Pour le week-end, il faudrait instaurer un système d’astreinte tournante, comme dans les hôpitaux : une seule personne désignée, et non pas toute l’équipe sur le qui-vive.
Du côté des politiques publiques, la clé reste la mise en place d’une garde d’enfants universelle. À la maison, le levier le plus décisif, c’est la simplification : savoir dire non aux obligations accessoires. Concrètement, cela signifie s’autoriser à renoncer aux cupcakes d’anniversaire décorés à la main si les acheter en magasin vous fait gagner des heures précieuses. The squeeze est passager, mais le burn-out, lui, peut laisser des traces durables.
Le temps est une ressource fondamentale du bien-être. Quelle règle de décision recommandez-vous pour savoir quand « racheter du temps », par exemple en déléguant une tâche, plutôt que de l’investir directement dans la travail domestique ou les loisirs ?
La clé, c’est de comprendre le coût d’opportunité de son temps. Celui des hommes est généralement perçu comme rare et de grande valeur. Les femmes doivent appliquer la même logique. La question à se poser est simple : m’embaucherais-je moi-même pour accomplir cette tâche, à mon propre taux horaire ? Si la réponse est non, alors mieux vaut la déléguer. Et surtout, il faut se défaire de toute culpabilité : déléguer n’est pas un échec, c’est un choix rationnel face à des contraintes réelles.
Vous évoquez aussi la charge invisible des tâches sans perspectives de promotion. Quel dispositif faudrait-il mettre en place, dès demain, pour en répartir le poids plus équitablement ?
Une répartition équitable et une reconnaissance explicite. Les entreprises devraient recenser ces tâches et instaurer une rotation : organisation des réunions, participation aux comités DEI (diversité, équité, inclusion), rôle de « ciment social » au bureau. Si c’est assez important pour être fait, c’est assez important pour être évalué et reconnu.
Les systèmes d’évaluation doivent les consigner, et les entretiens annuels en tenir compte. Et si l’entreprise ne prend pas l’initiative, les femmes peuvent aussi reformuler ainsi : « Je serais ravie de contribuer, mais comment s’assurer que cela sera pris en compte dans mon entretien d’évaluation ? » C’est ainsi que le travail invisible cesse de l’être.
La garde d’enfants, infrastructure clé de l’égalité
Abordons la question de la garde d’enfants — à la fois son coût et ses effets redistributifs. Si elle était considérée non plus comme un luxe privé mais comme une véritable infrastructure, quels changements attendez-vous en matière de participation des femmes au marché du travail, de progression salariale et de perspectives de promotion ?
Ils seraient transformateurs. D’abord, nous verrions une hausse de la participation et du maintien en emploi, en particulier pendant les premières années de la petite enfance. Les femmes n’auraient plus besoin de quitter leur poste simplement pour pouvoir financer une garde d’enfants de qualité. Ensuite, l’accès à des services abordables réduirait l’écart en matière de salaires et de promotions. Mais il faut aussi reconnaître qu’un certain nombre de femmes, notamment les plus aisées, choisissent de rester à la maison lorsqu’elles en ont les moyens. Ce choix devrait être accessible aux femmes à plus faibles revenus également : si elles souhaitent se consacrer à plein temps aux soins pendant ces premières années décisives, elles devraient en avoir la possibilité financière.
Les contraintes ne pèsent pas de la même façon sur toutes. Parmi les leviers liés aux inégalités raciales et sociales (subventions pour la garde d’enfants, contrôle des horaires, protections dans la fonction publique), lesquels réduiraient le plus rapidement les disparités qui affectent les femmes noires ?
Ces contraintes pèsent en effet plus lourd sur certaines femmes. L’ouvrage, The Double Tax: How Women of Color Are Overcharged and Underpaid d’Anna Gifty Opoku-Agyeman et Chelsea Clinton [N.D.L.R. publié le 16 septembre 2025 aux États-Unis, non traduit en France], montre combien les femmes racisées assument des charges particulièrement lourdes.
Pour les femmes de couleur et celles à faibles revenus, la priorité pour un effet rapide, c’est la maîtrise des horaires et des subventions de garde d’enfants de qualité : ces mesures s’attaquent directement à la pauvreté en temps et à la pression financière. Les protections de l’emploi dans la fonction publique jouent aussi un rôle, mais la flexibilité horaire reste le levier le plus immédiat. Enfin, il faut repenser notre manière de parler du soin : « s’arrêter » est souvent présenté comme une « pénalité », alors qu’en réalité cela peut être un privilège auquel toutes n’ont pas également accès selon la race et la classe sociale.
Dans The Double Tax : How Women of Color Are Overcharged and Underpaid (Flatiron Books, 2025), Anna Gifty Opoku-Agyeman et Chelsea Clinton analysent le poids disproportionné des inégalités économiques subies par les femmes racisées.
Vous analysez aussi le couple comme un contrat économique. D’après vos recherches sur le collateralized marriage, comment faudrait-il repenser le partage des biens, les politiques du logement et le droit matrimonial afin que le mariage ne cantonne pas les femmes aux tâches domestiques, où leur pouvoir reste limité ?
Il faut envisager le mariage comme un accord économique, et pas seulement comme une aventure romantique.
Premièrement, le droit matrimonial doit garantir un partage équitable des biens, y compris des revenus futurs et des droits à la retraite.
Deuxièmement, les politiques du logement devraient permettre aux deux partenaires de préserver une stabilité après le divorce, par exemple, en assurant que le parent qui assume la charge principale puisse rester dans le logement.
Troisièmement, il s’agit en amont de sensibiliser les femmes, et plus largement les couples, aux implications économiques du mariage.
Avant de franchir le pas de la cohabitation ou du mariage, quels sont, selon vous, les cinq points de vigilance incontournables pour les femmes ?
La première question à se poser est simple : comptes joints ou séparés ? Ensuite, à quel nom sont enregistrés les biens principaux. Troisièmement, s’assurer que les biens communs ne servent pas à rembourser une dette individuelle. Quatrièmement, aborder clairement la répartition du travail domestique non rémunéré et des responsabilités de soin. Enfin, déterminer la transparence dont chacun.e disposera sur les contributions de l’autre.
Et les signaux d’alerte ? Ils apparaissent quand le partenaire balaye ces questions ou suppose d’emblée que vous « prendrez tout en charge », comme si cela allait de soi.
Si vous pouviez, dès demain, instaurer trois mesures — l’une au niveau fédéral, une autre dans les entreprises et une troisième au sein des foyers — pour redresser la courbe de participation des femmes au marché du travail, lesquelles privilégieriez-vous ?
Au niveau fédéral, j’instaurerais une garde d’enfants universelle et subventionnée. Dans les entreprises, j’exigerais une transparence claire sur la répartition des tâches promouvables et non promouvables. Et, au sein des foyers, j’en ferais une norme : des audits de temps permettant de mesurer la contribution de chacun.e, puis de rééquilibrer en conséquence. La contrainte du temps est bien réelle. Mais elle peut être repensée.
Traduction de l’anglais au français réalisée par Enflammé.e.s.
-
[1] Cette étude a été relayée par le magazine Newsweek le 7 juillet 2025.
[2] Le National Women’s Law Center (NWLC) est un institut américain pour l’égalité femmes-hommes.
[3] Le Bureau of Labor Statistics (BLS) est une agence fédérale américaine des statistiques du travail.