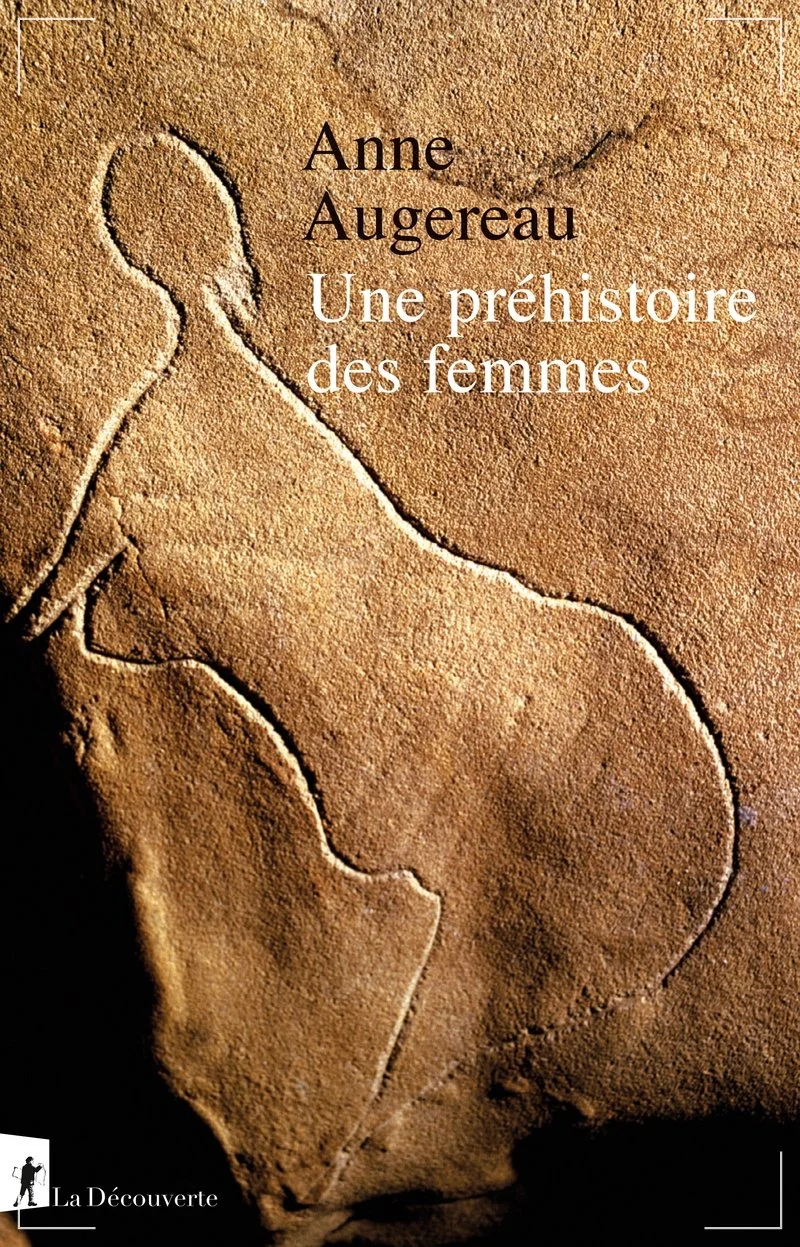Que sait-on vraiment des femmes préhistoriques ? Anne Augereau revient aux faits
Longtemps invisibilisées dans les récits scientifiques, puis parfois présentées comme les figures d’une égalité originelle perdue, les femmes préhistoriques se trouvent aujourd’hui au centre de nombreuses projections contemporaines. Mais que permettent réellement d’en dire les données archéologiques ? Activités quotidiennes, maternité, chasse, statut social, violences, rapports de pouvoir : dans Une préhistoire des femmes (Éditions La Découverte, 2026) Anne Augereau propose un examen méthodique des connaissances disponibles, du Paléolithique aux premières sociétés agricoles.
Dans un entretien accordé à Enflammé.e.s le 16 février 2026, l’archéologue revient sur plus de 300 000 ans d’histoire humaine pour comprendre comment se construisent, et parfois se déforment, nos récits sur les origines des rapports entre les sexes.
Archéologue à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et spécialiste du Néolithique, Anne Augereau a dirigé de nombreux chantiers de fouille et consacré plusieurs ouvrages aux rapports sociaux de genre dans les sociétés anciennes, notamment Femmes néolithiques. Le genre dans les premières sociétés agricoles (Éditions CNRS, 2021) et, avec Christophe Darmangeat, Aux origines du genre. Enjeux, méthodes et controverses (Éditions PUF, 2022).
Anne Augereau, archéologue à l’Inrap, spécialiste du Néolithique, publie ce jour Une préhistoire des femmes (Claire Delfino)
-
La Préhistoire correspond à l’ensemble des périodes précédant l’apparition de l’écriture, laquelle n’apparaît pas partout au même moment. Elle débute avec les premiers représentants de la lignée humaine, il y a plusieurs millions d’années, et s’achève progressivement lorsque certaines sociétés développent des formes d’écriture et des organisations étatiques.
Les principales périodes de la Préhistoire abordées dans l’entretien :
• Le Paléolithique (jusqu’à environ –12 000 ans) : sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, coexistence de différentes espèces humaines, dont Néandertal et Homo sapiens.
• Le Mésolithique (environ –12 000 à –6 000 ans) : période de transition marquée par des adaptations aux changements climatiques de fin de glaciation.
• Le Néolithique (environ –6 000 à –2 200 ans en Europe occidentale) : apparition de l’agriculture, de l’élevage et de formes de sédentarité durable, transformations majeures des organisations sociales et démographiques.Ces dates varient fortement selon les régions du monde, et les chercheur.euses rappellent que ces découpages restent des outils pratiques plutôt que des frontières nettes.
Lorsque l’on parle des « femmes préhistoriques », parle-t-on d’un sexe biologique, d’un genre social, de statuts, de rôles ? Comment éviter de projeter nos catégories contemporaines sur des sociétés aussi anciennes ?
Par « femmes préhistoriques », j’entends d’abord un sexe biologique, parce que l’archéologie préhistorique travaille principalement à partir des squelettes, qui présentent des caractéristiques féminines ou masculines que l’on parvient à déterminer. Mais je ne m’en tiens pas à cette détermination : à partir de là, j’essaie d’ouvrir d’autres questions. Comment ont vécu ces femmes et ces hommes ? Quelles étaient leurs relations ? Mangeaient-ils la même chose ? À quel âge se mariaient-ils ? À quel âge avaient-ils des enfants ? Existait-il une division du travail entre hommes et femmes ?
Autrement dit, je pars du sexe biologique, mais j’y injecte toute une série d’autres critères qui permettent d’aborder la question du genre à la Préhistoire.
Quant au risque de projection, il est extrêmement difficile de s’en préserver, dans la mesure où nous disposons de très peu de données : pas de textes, quelques silex taillés, des squelettes, et de la céramique pour les périodes où ce type de production existe. Il est donc très facile de projeter sur ces sociétés nos propres manières de penser les relations entre hommes et femmes.
La seule manière, à mon sens, de limiter ces projections consiste à s’enfoncer dans les données archéologiques et à leur poser des questions extrêmement précises, notamment sur la domination masculine. Car la domination masculine a été mise en évidence dans une très grande diversité de sociétés humaines observées par l’ethnologie [1], l’anthropologie [2], la sociologie, mais aussi en histoire : il existe une véritable profondeur de champ sur cet aspect. Il faudrait donc examiner les leviers de cette domination : sont-ils présents, ou non, en Préhistoire ? C’est en procédant ainsi, avec prudence, que l’on peut tenter de s’affranchir, autant que possible, des projections que l’on ne cesse d’émettre dès lors que l’on travaille sur des périodes aussi anciennes et aussi peu documentées.
Quelles sont aujourd’hui les données les plus solides pour reconstituer les parcours de vie des individus préhistoriques ?
Nous disposons aujourd’hui de plusieurs types de données permettant de retracer ce que l’on pourrait appeler les biographies des individus : femmes et hommes, jeunes et vieux, mais aussi les enfants.
Pour cela, nous avons à disposition différents outils. L’un des plus importants est l’ADN ancien, qui permet de restituer les liens de parenté biologique entre individus. C’est un apport majeur, même s’il s’agit d’un développement relativement récent dans son application à l’archéologie et, plus spécifiquement, à la Préhistoire.
Nous disposons également de données sur l’alimentation, obtenues grâce à des analyses chimiques pratiquées sur les ossements humains. Elles permettent, avec un certain nombre d’incertitudes, de déterminer si l’alimentation était plutôt d’origine animale ou végétale et, parfois, de mettre en évidence de légères différences entre hommes et femmes sur ce plan.
Pour approcher les activités pratiquées, on observe les déformations osseuses. Lorsqu’une activité est exercée de manière suffisamment intense et répétée au cours de la vie, elle peut laisser des traces sur le squelette. Ainsi, certaines lésions, par exemple au niveau du coude, peuvent être compatibles avec certains gestes, comme le lancer d’une arme. Mais il faut être extrêmement clair : ce n’est jamais une preuve absolue. On peut dire qu’un type de déformation est compatible avec une activité donnée, mais on ne peut pas affirmer avec certitude qu’elle a été pratiquée.
Enfin, les objets funéraires apportent eux aussi des informations importantes notamment grâce à l’analyse très fine des outils déposés dans certaines tombes. L’étude des microtraces permet d’identifier les matières travaillées telles que le cuir, la peau, les matières végétales, entre autres. Là encore, il s’agit d’indices, qu’il faut manier avec prudence.
-
ADN ancien : un matériau fragile, mais riche en informations
L’ADN se décompose naturellement et sa séquence s’altère au fil du temps : dans des restes fossiles vieux de milliers d’années, il ne subsiste souvent que des fragments très courts, mêlés à l’ADN de bactéries, champignons, végétaux ou humains ayant manipulé les ossements. Sa conservation dépend notamment de l’humidité, de la température et de l’activité microbienne : les milieux froids et secs y sont plus favorables que les environnements chauds et humides.
Pour limiter les contaminations, l’extraction se fait avec de fortes précautions, en laboratoire spécialisé : une salle blanche sous pression, exposée aux UV, puis un prélèvement par fraisage d’un fragment d’os, purification et séquençage. Les chercheurs trient ensuite, par bioinformatique, l’ADN du fossile et celui des autres organismes.
Dater : comparer les couches, puis mesurer le temps
Pendant longtemps, les archéologues ont surtout utilisé la stratigraphie : les couches de sédiments s’accumulent et permettent de dire qu’un objet est « plus récent que » ou « plus ancien que » un autre. C’est la datation relative, utile mais peu précise, et parfois trompeuse si les strates ont été perturbées.
Quand c’est possible, on recourt à des méthodes « absolues » fondées sur la radioactivité. Le carbone 14 sert à dater des matières organiques jusqu’à environ 50 000 ans, tandis que d’autres méthodes, comme le thorium-230 (carbonates de grotte) ou l’argon-40 (minéraux volcaniques), permettent de remonter plus loin. Ces techniques comportent des marges d’erreur : les spécialistes en combinent souvent plusieurs pour vérifier leurs chronologies.
Enterrer : comment démontrer une inhumation intentionnelle ?
L’idée que Néandertal enterrait ses morts a longtemps été discutée. Une étude récente sur le site de La Ferrassie (France) a permis de démontrer l’inhumation d’un enfant néandertalien d’environ deux ans, grâce à l’analyse des couches stratigraphiques et à la comparaison de l’état de conservation des restes humains et animaux. Les chercheurs ont notamment montré que le corps avait été déposé dans une fosse creusée, il y a environ 41 000 ans. Cette démonstration indique que l’existence de pratiques funéraires en Europe de l’Ouest ne dépend pas de l’arrivée d’Homo sapiens.
Source : Muséum national d'Histoire naturelle de Paris
Que permettent aujourd’hui d’affirmer les données archéologiques sur la vie quotidienne des femmes ?
Ce que montrent d’abord les données archéologiques, c’est une tendance générale : la manipulation des armes létales, arc, flèches, sagaies, mais aussi certaines haches pouvant servir au combat, semble avoir concerné majoritairement des hommes. Chez les femmes étudiées, on ne retrouve presque jamais les déformations osseuses observées chez certains hommes, notamment au niveau des coudes, des épaules ou des poignets, et qui sont compatibles avec le tir à l’arc ou le lancer d’armes.
En revanche, les femmes présentent d’autres types de déformations, notamment au niveau des biceps et des avant-bras, indiquant des mouvements répétés de va-et-vient effectués avec les deux bras. Pour le Néolithique, ces marques pourraient correspondre à des activités comme la mouture des céréales, puisque l’agriculture et la culture des grains apparaissent à cette période. Mais cette interprétation reste, là encore, hypothétique.
On observe également, surtout pour le Néolithique, période pour laquelle les données sont les plus abondantes, que les femmes ont probablement travaillé davantage des matières souples, comme le cuir, certaines matières végétales, et très vraisemblablement l’argile destinée à la poterie. Les outils retrouvés dans certaines tombes portent en effet des traces d’utilisation associées au travail de ces matériaux.
“Ces éléments dessinent ainsi une division du travail perceptible à grands traits, même si cette lecture repose toujours sur des indices qu’il faut interpréter avec prudence.” – Anne Augereau
L’idée selon laquelle les femmes participaient à la chasse au grand gibier circule régulièrement. Que permettent réellement d’en dire les données archéologiques ?
On trouve effectivement, dans quelques rares sépultures féminines, des armes déposées aux côtés des défuntes. C’est un point important, car la très grande majorité des dépôts d’armes concerne des hommes. Ces femmes constituent donc une dérogation au cas général.
La question est alors de comprendre pourquoi. S’agit-il d’une transgression de règles sociales qui assignaient habituellement certaines activités aux hommes ? Ou bien existait-il, dans certains contextes, une forme de genre particulier, permettant à certaines femmes, à un moment donné, d’être considérées comme des hommes et d’exercer les activités qui leur étaient associées ?
Nous avons cependant beaucoup de questions et très peu de réponses assurées. La difficulté tient au fait que l’on passe souvent trop vite de quelques cas isolés à une affirmation générale selon laquelle les femmes auraient été des chasseuses de grand gibier. C’est, à mes yeux, une évidence trompeuse. Ces cas minoritaires doivent au contraire être interrogés avec prudence, sans en déduire une égalité généralisée entre hommes et femmes dans ces activités particulièrement valorisées.
Peut-on donner un ordre de grandeur : combien de sépultures féminines associées à des armes connaît-on selon les périodes ?
Je ne les ai pas comptées, et il faut rester prudente : tous les individus fouillés n’ont pas été « sexés », c’est-à-dire attribués à un sexe biologique
Si l’on se limite au Paléolithique récent en Europe, on dispose déjà de très peu de sépultures à l’échelle du continent, pas plus de deux cents, tous les morts n’étaient pas forcément enterrés : certains individus ont sans doute eu d’autres modes d’inhumation. Dans ce cadre, à ma connaissance, il n’y aurait pas de sépulture féminine associée à des armes en Europe. En revanche, on en mentionne ailleurs, notamment au Pérou, où une sépulture aurait été découverte avec une jeune fille et des armes de chasse, du moins d’après les archéologues qui l’ont fouillée. Cela reste, en tout état de cause, extrêmement rare.
Pour le Mésolithique, les données sont plus nombreuses, même si l’identification des individus demeure inégale. Je n’ai pas de chiffres précis, mais, pour les cas que l’on connaît, on serait sur trois, quatre, cinq femmes présentant cette particularité, sur un ensemble global d’environ deux mille individus, avec toutefois des niveaux d’information très hétérogènes selon les sites, notamment sur le sexe et le contenu des sépultures.
Un point demeure essentiel : la rareté de ces cas ne signifie pas que les femmes ne participaient jamais à la chasse. Si la manipulation des armes létales relève plutôt des hommes, il est possible que la mise à mort du gros gibier ait été majoritairement masculine.
Dans Une préhistoire des femmes (Éditions La Découverte, 2026), Anne Augereau examine la place des femmes du Paléolithique au Néolithique.
Comment penser la participation des femmes à la chasse sans la réduire au modèle « arc et flèches » ?
D’abord, il faut rappeler que la chasse peut être collective. Dans le cas de Néandertal, qui chasse de très grands animaux comme les mammouths, il est possible d’imaginer des stratégies consistant à orienter les animaux vers un précipice, un ravin ou une zone d’enlisement, afin de faciliter leur abattage. Dans un tel cadre, il est possible que le rabattage ait été effectué par des jeunes et par des femmes.
Ensuite, l’ethnologie montre que, dans certaines sociétés, les femmes chassaient plutôt de petits animaux : par piégeage, ou en les assommant à l’aide d’instruments contondants, sans nécessairement utiliser les armes létales typiquement associées aux hommes comme l’arc, les flèches et les sagaies. Or, dans les sites paléolithiques et mésolithiques, on retrouve, aux côtés du grand gibier, toute une série de petits animaux. On peut donc envisager, si l’on établit un parallèle prudent avec les données ethnologiques, que certaines de ces captures aient pu relever d’activités féminines.
Ce que les données révèlent, et ce qu’elles ne permettent pas d’affirmer
Que sait-on aujourd’hui de la prise en charge des jeunes enfants dans les sociétés préhistoriques ?
Pour les tout-petits, il est très probable que la mère s’occupe de l’enfant jusqu’à l’introduction d’une nourriture solide, c’est-à-dire jusqu’au début du sevrage. D’après les estimations obtenues grâce à des analyses spécifiques des dents, la durée de l’allaitement exclusif se situerait entre la naissance et environ six mois. Cette durée apparaît comme une constante que l’on retrouve à travers les différentes périodes de la Préhistoire, depuis Néandertal jusqu’à la fin du Néolithique.
Durant ces six premiers mois, on peut penser que la mère en assure la prise en charge la majeure partie du temps : le nourrisson doit téter très fréquemment. Il est donc possible que le soin des tout-petits soit, dans les premières semaines ou les premiers mois, essentiellement maternel. Cela n’exclut pas qu’elle continue certaines activités : elle pouvait, par exemple, porter l’enfant sur son dos dans des dispositifs permettant de dégager les mains.
À partir du moment où l’enfant commence à absorber une nourriture solide, il pourrait être pris en charge par d’autres membres du groupe, l’alimentation ne dépendant plus exclusivement du lait maternel.
« Mais il faut le rappeler : les données demeurent très limitées et l’archéologie ne permet pas d’identifier précisément qui prendrait alors le relais. Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. »
A-t-on identifié des différences de traitement entre filles et garçons pendant l’enfance ?
C’est très compliqué d’obtenir des informations fiables sur le sexe des enfants. Pour les adultes, on se fonde souvent sur la forme du bassin ; or, chez les enfants, les caractères sexuels du bassin n’apparaissent qu’à compter de 16–17 ans. En deçà, on ne parvient donc pas facilement à distinguer garçons et filles.
D’autres méthodes existent, notamment l’analyse ADN, mais elles sont encore rarement mobilisées pour ces populations anciennes. Résultat : nous disposons de peu d’informations sur les filles et les garçons.
Le peu que l’on sait concerne surtout le Néolithique. Il semblerait qu’on puisse observer une dissociation de l’alimentation des filles et des garçons aux alentours de huit ans ; mais il faut être extrêmement prudent, car nous avons très peu d’individus permettant d’étayer ce constat. En fait, on n’a qu’un seul cas : une petite fille du Bassin parisien néolithique qui, vers huit ans, aurait absorbé d’autres types d’aliments que des individus masculins. Cela repose sur un seul individu : il est donc très difficile d’en faire une généralité. Dans l’état actuel des informations, on commence néanmoins à disposer d’une approche prometteuse, qui donne déjà des résultats, mais qui mériterait davantage d’études.
Que peut-on dire des contraintes liées à la grossesse et à la maternité, sans réduire les femmes à leur fonction reproductive ?
Les données restent lacunaires, mais un élément ressort néanmoins : les âges moyens de la maternité seraient, en moyenne, six ans plus précoces que les âges moyens de la paternité. Ce constat aurait été observé sur la longue durée grâce à des analyses ADN menées de manière systématique.
Cette différence suggère que les femmes devenaient mères plus jeunes que les hommes ne devenaient pères. Mais comment interpréter cet écart ? Relève-t-il d’une contrainte, d’une forme de coercition, ou de règles sociales pesant différemment sur filles et garçons ? Sur ce point, nous ne pouvons pas trancher. On peut seulement envisager qu’il s’agisse d’un phénomène social, possiblement combiné à des facteurs physiologiques, la période de fécondité féminine étant plus longue.
La manière concrète dont cela se traduisait dans la vie des femmes, qu’il s’agisse de violences, de pressions psychologiques ou d’autres formes de contrainte, nous échappe entièrement. Nous sommes donc contraints de rester dans le domaine des hypothèses, non des certitudes.
On observe d’ailleurs encore aujourd’hui, dans de nombreuses sociétés, des écarts d’âge au mariage, les hommes étant souvent un peu plus âgés que les femmes. Cela peut faire écho à ces données anciennes, mais il faut se garder d’en tirer des conclusions directes pour la Préhistoire.
À quelles conditions une sépulture riche permet-elle de parler de statut social ou de pouvoir ?
Une tombe n’est jamais un lieu neutre : le rite funéraire est un événement social. Il dit quelque chose de la manière dont une société met en scène la mort et, dans une certaine mesure, la manière dont elle peut aussi mettre en scène un statut.
On peut parer le défunt de vêtements ornés, de perles abondantes, de bijoux ; déposer des objets du quotidien et, pour certains hommes, des armes ; ou encore placer auprès de lui des objets provenant de loin, en matières premières rares, ou importées, que l’on peut interpréter comme des biens de prestige. Mais il faut rester prudent : la rareté ou l’origine lointaine de ces objets peuvent signaler une valeur sociale particulière, sans constituer à elles seules une preuve.
Un autre critère important réside dans les différences observées entre tombes : certains individus reçoivent de nombreuses parures, armes ou objets rares, quand d’autres en ont très peu. C’est dans cette distribution inégale que l’on peut envisager l’existence d’un statut particulier pour certains individus, voire d’une forme d’élite.
Plus largement, un dépôt funéraire peut renvoyer à des significations multiples : activité, genre, qualité, statut ou dimension symbolique. Une tombe dite « riche » doit donc être interprétée à partir d’un ensemble d’indices plutôt que d’un seul marqueur.
Observe-t-on également des sépultures féminines riches, ou ces marqueurs de prestige restent-ils majoritairement masculins ?
Au Néolithique, hommes et femmes peuvent être associés à des objets particuliers, mais pas aux mêmes types d’objets. Chez les femmes, on observe surtout des parures et des bijoux, parfois en or et en cuivre dans certaines régions. Chez les hommes, on trouve aussi des parures, mais également des armes et des outils, y compris des objets provenant de régions éloignées, qui peuvent constituer des biens de prestige.
On connaît par ailleurs de grands ensembles funéraires, notamment en Bulgarie, où se distingue une élite à travers l’abondance des dépôts : elle apparaît très nettement chez des hommes, mais aussi chez quelques femmes. Globalement, les sépultures masculines demeurent souvent plus riches, mais certaines femmes très abondamment parées semblent avoir appartenu, avec certains hommes, à une élite, autrement dit à un groupe social au statut particulier.
L’apparition des inégalités entre les sexes
Quand apparaissent les inégalités entre les sexes ? Peut-on dater une rupture durable défavorable aux femmes ?
Il est extrêmement difficile de répondre, car tout dépend de ce que l’on entend par « rupture défavorable ». Si l’on s’intéresse aux violences, on en observe des traces très anciennes, au moins dès Néandertal, autour de 300 000 ans avant le présent. Mais leur interprétation reste délicate : il n’est pas toujours possible de distinguer des violences interpersonnelles de simples accidents.
Pour des périodes plus récentes, certains contextes apparaissent plus parlants. Sur le site néolithique de Çatalhöyük, en Anatolie où de nombreux hommes et femmes ont été étudiés, on observe des blessures compatibles avec des violences interpersonnelles chez les femmes à tous les âges, alors que, chez les hommes, elles concerneraient surtout les individus jeunes. Cela pourrait suggérer, dans ce contexte précis, une violence plus durable dans la vie des femmes. Toutefois, il demeure difficile d’étendre cette observation à l’ensemble du Néolithique ou à toutes les régions.
On constate également qu’au Néolithique, alors même que la population augmente, les premières phases s’accompagnent d’une dégradation générale de la santé qui semble toucher davantage les femmes, même si les hommes connaissent eux aussi des difficultés. Dans le même temps, le nombre de grossesses augmente, en lien avec la croissance démographique. L’ensemble pourrait donc être interprété comme une évolution défavorable aux femmes, sans que l’on puisse considérer cette dynamique comme uniforme ni représentative de toutes les sociétés.
Plus largement, lorsqu’il s’agit de rapports sociaux en Préhistoire, on ne peut guère dépasser le stade des probabilités, à condition de maintenir une méthodologie rigoureuse fondée sur les données disponibles et leurs limites.
Peut-on évoquer l’émergence de la domination masculine sans surinterpréter les données ?
Il semble exister une constante, du moins à l’échelle de la préhistoire telle que je l’ai étudiée : la manipulation des armes létales apparaît essentiellement comme une affaire d’hommes, même si le degré de certitude varie selon les périodes. Or, dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs ou d’agriculteurs, la possession et l’usage des armes constituent l’un des leviers majeurs de la domination masculine, puisqu’ils impliquent la force et, potentiellement, un droit de vie et de mort. Si ce levier est ancien, on peut donc envisager que la domination masculine le soit également, tout en restant dans l’hypothèse, car il ne s’agit pas d’une preuve directe.
La question des mythes apporte un autre éclairage. Certains chercheurs, comme Jean-Loïc Le Quellec et Julien d’Huy, travaillent sur la phylomythologie [3] et proposent, à partir d’un faisceau d’indices, que le mythe d’un matriarcat primitif aurait été largement diffusé à travers les continents et pourrait s’être propagé depuis l’Afrique il y a environ 65 000 ans.
L’enjeu n’est pas d’y voir la trace d’une réalité historique, mais d’interroger la fonction de ce mythe. Il ne se contente pas d’affirmer que les femmes dominaient autrefois ; il suggère surtout qu’elles dominaient mal et qu’il aurait donc fallu les priver de ce pouvoir. Autrement dit, il fonctionnerait comme un récit de légitimation de la domination masculine.
Là encore, il ne s’agit que d’hypothèses, mais elles invitent à réfléchir à l’ancienneté possible de tels mécanismes.
Que révèle notre fascination actuelle pour les femmes préhistoriques sur nos préoccupations contemporaines ?
L’intérêt actuel pour les femmes préhistoriques est, à mes yeux, une bonne chose, car il traduit une interrogation essentielle : comprendre d’où vient la domination masculine et pourquoi elle persiste, même si elle a reculé. Interroger ces phénomènes dans le temps long permet d’en mesurer l’ancienneté et, peut-être, de mieux penser les combats contemporains.
Il existe toutefois un risque : celui de projeter sur ces femmes préhistoriques ce que nous souhaiterions qu’elles incarnent aujourd’hui. On tend parfois à infléchir les données pour leur faire dire qu’elles étaient pleinement égales des hommes, qu’elles participaient à la chasse ou à la guerre, qu’elles choisissaient librement leurs partenaires. Cette tentation ne concerne pas seulement le grand public ; elle peut aussi toucher certains chercheurs.
Or ce n’est pas en fabriquant un passé conforme à nos attentes que l’on combattra plus efficacement la domination masculine. La seule voie possible consiste à examiner rigoureusement les données archéologiques, même lorsque leurs conclusions sont moins confortables que les récits que l’on aimerait entendre. Comme le rappelle Christophe Darmangeat, le combat des femmes n’a pas besoin de chimères ni de fausses informations.
Quelles pistes de recherche devraient être explorées en priorité aujourd’hui ?
Il faudrait d’abord explorer ce que l’on pourrait appeler la diversité interne des groupes étudiés. On cerne globalement les hommes, et l’on cerne de mieux en mieux les femmes, mais il existe des sous-groupes encore mal compris. Ainsi, pourquoi certaines femmes sont-elles enterrées avec des armes ? Ont-elles un âge particulier, une alimentation spécifique, un parcours de vie distinct ? À l’inverse, quelles sont les caractéristiques des femmes très richement parées ?
On dispose déjà de quelques indices : certaines femmes âgées présentent une alimentation qui se rapproche de celle des hommes, avec davantage de protéines animales en fin de vie. Cela suggère des trajectoires féminines différenciées plutôt qu’un groupe homogène.
Un autre chantier majeur concerne l’enfance : comprendre à quel moment les apprentissages commencent à se différencier selon le sexe, et selon quelles modalités. Pour l’instant, les données demeurent trop limitées pour trancher.
Enfin, il faudrait mieux comprendre les systèmes de parenté. La patrilocalité, les femmes rejoignant la communauté du mari, semble ancienne, mais certains indices suggèrent également des mariages matrilocaux. Explorer cette diversité des systèmes matrimoniaux et des formes de parenté constitue donc un enjeu important pour les recherches à venir.
-
[1] Discipline scientifique qui étudie une société ou une communauté particulière à travers l’analyse descriptive et interprétative de ses pratiques, de ses représentations et de ses organisations sociales. Elle s’attache à comprendre les spécificités culturelles d’un groupe donné.
[2] Champ de recherche qui examine les sociétés humaines dans une perspective comparative, en s’intéressant aux phénomènes, aux structures et aux processus susceptibles d’être observés à l’échelle de l’ensemble des sociétés humaines.
[3] Approche issue de la mythologie comparée qui applique aux récits traditionnels des méthodes empruntées à la phylogénétique, discipline utilisée notamment en biologie pour reconstituer des arbres d’évolution.Elle repose sur l’analyse de la diffusion géographique des motifs mythologiques (aréologie) et sur la construction d’arbres et de réseaux permettant de remonter vers des formes narratives plus anciennes.
L’objectif n’est pas de démontrer la véracité historique d’un mythe, mais d’en reconstruire les trajectoires de transmission et, parfois, d’en proposer une forme ancestrale, qui pourrait, selon cette approche, remonter aux premières migrations d’Homo sapiens hors d’Afrique.